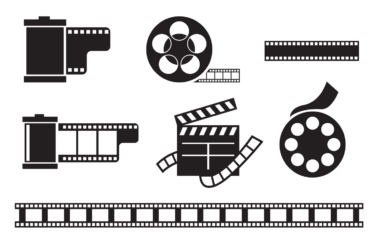Depuis quelques années, la France, l’Europe ou tout simplement les grandes capitales occidentales ont décidé, parlant de la Côte d’Ivoire que « c’est ici que ça se passe », et cela dans plusieurs domaines : implantations d’industries, résidences d’ambassadeurs, sièges d’organismes internationaux, grandes rencontres internationales, etc…Il n’y a que pour la culture qu’on pouvait dire parlant du Burkina, que « c’est ici que ça se passe ». Très récemment encore l’attaché audiovisuel régional de l’Ambassade de France résidait au Burkina et s’occupait d’Abidjan et de Niamey.
Pour la culture et surtout le cinéma /audiovisuel qui m’intéresse dans cet article, ces mêmes capitales disent à nouveau « C’est en Côte d’Ivoire que ça se passe ». C’est désormais fini pour le Burkina, et en la matière, après Abidjan c’est Dakar.
Les deux pays se partagent bien les rôles. En termes de productions culturelles ou médiatiques internationales à gros budgets tels que « l’Afrique a un Incroyable Talent », « Parlement du Rire » prochains « festivals série série », « DISCOP », « Parlement du Rire », c’est Abidjan.
Pour les tournages de films, de série TV étrangères ou locales, c’est encore la capitale ivoirienne qui s’en tire avec plus de la moitié des tournages dans notre sous- région, suivie de près par la capitale sénégalaise. C’est à Abidjan également que sont basées les filiales des grands médias tels que Studio Canal, Lagardère etc…, les GAFA tels que Dailymotion, et les grands labels de musique comme SONY ou UNIVERSAL, etc.
Mais si Dakar ne peut égaler Abidjan en termes de volumes d’activités culturelles tous genres confondus, la capitale sénégalaise s’en tire avec au moins une quinzaine de tournages de longs- métrages, de documentaire, et de série TV étrangères ou locales chaque année. Jusqu’à une date récente cette activité était complétée par les productions maisons financées en partie par l’État sénégalais.
Et Ouagadougou dans tout ça ?
Curieusement c’est la pandémie de coronavirus qui a attiré l’attention des autorités, des médias et même du grand public burkinabé, sur l’état d’effritement de la culture au Burkina. Certains ont vite fait de mettre tous les problèmes de ce secteur (Cinéma, théâtre, musique, danse, arts plastiques, festivals de jazz, de rock, etc.) sur le dos de cette pandémie. D’autres avaient déjà accusé la crise sécuritaire d’être responsable du marasme culturel actuel, c’est totalement faux. Cette maladie a tout juste servi de révélateur à la grave crise qui mine tout le secteur culturel burkinabè depuis au moins 20 ans.
En effet avant la crise sécuritaire que nous traversons, la production culturelle burkinabé dans son ensemble ne tenait plus qu’à un fil. Ce dernier fil a été effectivement coupé par l’insécurité, si bien que le coronavirus est apparu quand il n’y avait plus de fil à couper, tout était par terre.
De toute façon, qu’on le veuille ou pas, les chiffres du secteur phare de notre culture, à savoir le cinéma, sont là. Comme dirait le président rwandais à propos d’autre chose, « les faits sont têtus ».
Commençons par le nombre de salles de cinéma. Une des bases de l’industrie cinématographique.
En 1970 notre pays avait 6 salles pour cinq millions six cent mille (5 600 000) habitants soit une salle pour 933 000 personnes.
Dans les années 1980 on a 12 salles pour sept millions (7 000 000) d’habitants soit une salle pour 583 000 personnes.
En 1990, on vient de sortir fraichement de la révolution burkinabé, on passe à une cinquantaine de salles pour neuf millions (9 000 000) d’habitants soit une salle pour 180 000 personnes. C’est l’âge d’or, mais il sera de très courte durée.
La descente aux enfers
La marche à reculons commence déjà en 1995 avec une quarantaine de salles fonctionnelles pour une population de 10 millions d’habitants, soit une salle pour 250 000 cinéphiles.
Enfin à partir de 2018 on patauge carrément avec trois (3) salles de ciné pour dix-neuf millions d’habitants, le Ciné Burkina, le Ciné Neerwaya à Ouaga et le ciné Sanyon à Bobo-Dioulasso, soit un rapport de six millions trois cent mille (6 300 000) habitants pour une salle de cinéma. Pour info la plus grande salle a mille (1000) places.
On mérite d’apparaître dans le livre Guinness des records en la matière.
Pour compléter cette info sur les lieux de projection, il faut mentionner la salle de l’Institut Français, et deux (2) nouvelles salles du groupe Vivendi. Mais dans les faits très peu de films burkinabé passent dans ces salles.
Quelques salles de quartier ou de province vivotent, en déphasage total avec le niveau de la population actuelle. Même le moins gradé des cireurs de chaussures hésite à y aller avec ses copains ou sa copine. Ce sont les salles appelées « cocos taillées » ou salles non couvertes, où le cinéphile lutte constamment avec les odeurs d’urine et les moustiques.
Les salles CENASA, Jean PIERRE GUINGANE, Palais de la Culture de Bobo sont des salles de projection par défaut. En effet leurs configurations initiales et leurs installations techniques sont loin d’être adaptées à une exploitation cinématographique. Du coup, ni les cinéastes, ni les cinéphiles ne s’y bousculent pour montrer ou voir des œuvres. Elles sont plus des salles de réunion que de projection.
Pour conclure en partie sur les salles il faut noter qu’aucune des trois salles, (borgnes au pays des aveugles), Ciné Burkina, Ciné Neerwaya, ou Ciné Sanyon n’est équipée aujourd’hui pour une projection aux normes professionnelles. Le minimum d’équipement dans le monde est un projecteur DCP(digital cinéma package) avec tous ses accessoires.
Pour les dernières éditions du Fespaco, les techniciens et le matériel sont venus d’Europe avec justement tout le matériel DCP afin d’équiper les 2 salles de Ouaga pour les 7 jours de l’évènement. À leur départ, on a repris nos projections avec des vidéoprojecteurs amateurs posés au milieu des cinéphiles comme lors des mariages ou les baptêmes de quartier. Seules les salles du groupe Vivendi et de l’Institut Français ont le matériel approprié.
Pourtant l’équipement d’une salle en matériel numérique DCP coûte environ 60 000 euros. Les travaux incontournables dans la cabine de projection et la salle du public s’estiment à 20 000 euros soit au total 80 000 euros ou 53 000 000 de FCFA. Quels que soient les frais liés à l’équipe technique étrangère chargée de ces installations on sera dans la fourchette de 65 millions de FCFA par salle de ciné (100 000 euros).
Après les lieux d’exploitation des films, la transition est facile pour parler du financement des films, l’autre base de l’industrie cinématographique.
Commençons par ces deux acronymes, le FONSIC et le FOPICA, qui ne vous disent rien certainement, mais qui sont bien connus des professionnels du cinéma africain.
Le FONSIC c’est le Fonds de Soutien à l’Industrie Cinématographique de Côte d’Ivoire doté (officiellement) de 600 millions à 1 milliard de FCFA par an et le FOPICA c’est le Fonds de Promotion de l’Industrie Cinématographique du Sénégal doté (officiellement) de 1 à 2 milliard de FCFA par an.
Avant la création de ces fonds nationaux, les cinématographies de ces deux pays comme celles d’autres pays francophones d’Afrique devaient en grande partie leurs existences aux différents fonds européens.
L’ex-ministre de la Culture de Côte d’Ivoire, Maurice Bandama disait ainsi dans une Interview à Jeune .Afrique du 21 mars 2018 « …Avant la création du FONSIC, le cinéma ivoirien était mort », puis il ajoute plus loin, je cite « ce sont ces fonds (européens NDLR) qui ont permis à des cinéastes comme Timité Bassory (Côte d’Ivoire), Désiré Ecaré (Côte d’Ivoire)… d’exercer leur art dans des conditions professionnelles ». Fin de citation.
Et la liste des cinéastes est longue, Henri Duparc, Idrissa Ouédraogo, Sembène Ousmane, Gaston Kaboré, Souleymane Cissé, Pierre Yaméogo, etc…doivent en très grande partie leurs carrières à ces guichets occidentaux ou basés en Occident. On peut citer, l’ACCT devenu OIF, le Fonds Image Afrique (France), le MAE, (Ministère Français des Affaires Étrangères), Cinéma du Monde (France), le Fonds Afrique-Caraïbes-Pacifique/Union Européenne (ACP/UE), le Centre National du Cinéma (CNC France) Vision Sud-Est (Suisse), World Cinema Fund (Allemagne), Hubert Bal (Hollande) le COE (Italie), etc.
Mais cela ne pouvait durer éternellement. En effet certains de ces fonds n’existent plus, d’autres ont été drastiquement réduits pour ne s’occuper que de leurs propres cinématographies, et les derniers se sont ouverts à tous les pays en voie de développement (et pas seulement ceux d’Afrique).
Du coup les cinématographies africaines surtout francophones qui étaient adossées uniquement à ces fonds se sont retrouvées le bec dans l’eau. De ce lot ou de cette eau, je prendrai 2 pays d’Afrique qui ont décidé d’émerger en prenant eux-mêmes en charge leurs cinémas. Il s’agit du Sénégal, et de la Côte d’Ivoire. Ensuite on évoquera le Rwanda (qui n’est plus francophone) et qui a une cinématographie plutôt naissante.
Enfin le Maroc qui n’a jamais été vraiment dépendante des aides européennes et qui a certainement la cinématographie la mieux structurée du continent.
À propos du Rwanda, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, la victoire du Rwanda au dernier Fespaco (2019) n’était pas un jeu de diplomatie, mais une conséquence directe de l’investissement actuel que ce pays a entrepris dans ce secteur.
Pour preuve, lors du dernier Ouaga-Film Lab tenu juste après le Fespaco 2019, le Rwanda occupait une nouvelle fois 3 places du podium avec 3 nouveaux projets, en concurrence avec l’Ouganda, le Nigéria, la RDC, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina, etc. Je n’ai pas encore tous les détails de la dynamique rwandaise.
Revenons à la Côte d’Ivoire et à son FONSIC qui a été créé pour donner un nouveau souffle au cinéma ivoirien. Son bilan officiel depuis 2013 fait ressortir 18 longs métrages, 9 séries TV, 4 documentaires et 29 festivals financés.
Parmi les projets de 2018, selon un responsable du fonds (Interwiew AFP), on peut citer, la suite au film « l’interprète » de Khady Touré, « les frasques d’Ebinto » de Jean Louis Koula, « ligne 19 » de Owell Brown etc. et surtout le tout dernier film de Philippe Lacôte à hauteur de 200 millions de francs FCFA selon le réalisateur lui-même. L’appui moyen à un film long métrage cinéma est de 100 millions de FCFA. Il faut ajouter que le FONSIC est également ouvert aux projets de films burkinabè et à d’autres pays africains à condition d’avoir un coproducteur ivoirien.
Une preuve palpable de cette stratégie ivoirienne en marche est la mise en place du Fonds CLAP-ACP-FONSIC pour 2020 et 2021. Ce programme actuellement mené par le FONSIC avec la Contribution de l’Union européenne et le partenariat de l’OIF, d’un montant de Un Million Trente Six Mille (1 036 000) euros est destiné à « financer des coproductions associant la Côte d’Ivoire à des pays du groupe Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) dans les catégories longs-métrages de fiction (cinéma, animation, TV), courts-métrages, séries et documentaires ». Notre compatriote Boubacar Diallo est un des lauréats de ce fonds. Comme je vous le disais plus haut, ce n’est plus au Burkina que ça se passe.
Malgré ces chiffres et cette nouvelle dynamique qui font rêver le cinéaste burkinabè, ni les cinéastes ivoiriens, ni les autorités ne sont satisfaites, parce que le FONSIC et l’environnement cinématographique ivoirien ont encore beaucoup d’insuffisances. Et c’est tant mieux si tout le monde est d’accord sur ce point, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas prêts à dormir sur leurs lauriers. Loin de là !
Les autorités ivoiriennes ne font d’ailleurs aucun mystère de la stratégie qui sous-tend cet engagement de l’État. C’est celle de devenir selon l’ex- ministre Maurice Bandama « le champion du cinéma en Afrique Francophone avec au moins deux modèles en vue, la France et surtout le Maroc ».
Selon le ministre, le dossier cinéma est suivi personnellement par le président Alassane Ouattara d’où sa présence au dernier Fespaco.
Passons au Sénégal, l’autre pays francophone qui a décidé de prendre ses responsabilités vis-à-vis de son cinéma.
Parmi les films coproduits par le FOPICA, fonds créé en 2002 et réellement opérationnel que depuis 2015, on peut citer, le court métrage « Une place dans l’avion » de Khadidiatou Sow, le court métrage « Garmi » de Cheikh Diallo, « un air de Kora » de Angèle Diabang, « Ordur de Momar Talla » tous sélectionnés au Fespaco 2019. Si ces films ont reçu des appuis plutôt modestes de l’État sénégalais, le film « Félicité » du double Étalon du Fespaco Alain Gomis lui, a reçu 100 millions de francs cfa. Quant à sa compatriote Mati Diop, avec son film « Atlantique », elle a reçu majoritairement du Sénégal et modestement de la Côte d’Ivoire la somme de 286 millions de francs CFA environ.
Même si cet apport Sénégal-Côte d’Ivoire reste faible par rapport au budget global du film qui avoisine les 1 milliard 400 millions FCFA, dont l’Avance sur recettes du CNC (France), Cinekap (Sénégal) et d’autres guichets français et européens, il témoigne d’un intérêt certain des deux pays vis-à-vis du 7e art. Le résultat est que Mati Diop, franco-sénégalaise, est monté sur les plus hautes marches de Cannes, pour recevoir le Grand Prix du Jury, plus au nom du Sénégal que de la France.
Indépendamment de ce seul film, avec le FOPICA, le cinéma sénégalais tient là un instrument comparable à ceux des grandes cinématographies, avec un comité de gestion paritaire composé de représentants de l’État et de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel reconnus dans le monde, un collège de lectures des projets dont les membres (également des professionnels) ont des mandats limités dans la durée.
Le FOPICA ne finance pas à la tête du réalisateur ou du producteur mais selon la qualité du projet. Aux dernières nouvelles selon plusieurs sources, une volonté politique en dents de scie est en train de gripper cette belle machine de soutien et de promotion du cinéma sénégalais. Cela, pour dire que rien n’est définitivement acquis dans ce domaine.
Qu’en est-il du Burkina ?
Disons d’entrée de jeu que notre pays n’a aucune institution nationale destinée au soutien et à la promotion du cinéma et de l’audiovisuel, de type FONSIC, FOPICA, CCM (Centre Cinématographique Marocain) ou CNC français (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée). Ce dernier étant une des plus grandes références mondiales en la matière.
Concrètement comment la production cinématographique marche entre l’État burkinabé à travers son Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), et les cinéastes ? Selon les informations à la disposition des cinéastes que nous sommes, la dotation financière actuelle de la Direction Générale de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (DGCA) destinée au secteur culturel et touristique est tantôt de 40 millions de francs CFA (60 979 euros) par an, tantôt de 200 millions de francs CFA (304 898 euros) par an. Quel est le pourcentage réservé au cinéma ? Aucune idée.
Si l’on veut éviter les problèmes avec nos collègues du théâtre et surtout de la musique, prenons 30% de 40 millions de Fcfa, ce qui fait 12 millions Fcfa pour le cinéma, et si on applique ces 30% aux 200 millions, la part des cinéastes serait de 67 millions. Dans le cas de figure le plus optimiste, le secteur cinéma ne se contenterait que de 100 millions de Fcfa ou 152 449 euros soit la moitié de la dotation globale pour la culture et le tourisme pour les meilleures années.
La question suivante c’est comment un ou une cinéaste accède à une infime partie de ces éventuels 100 millions de Fcfa par exemple, lorsque il ou elle a un projet de film ?
Il n’y a aucun texte règlementaire selon mes informations. Chacun dépose son scénario avec le synopsis, le devis, le plan de financement, la liste technique et artistique etc… et fait des pieds et des mains pour être financé.
Le délai pour avoir une réponse à son dossier ? Il peut être d’un mois, de deux mois, d’un an ou jamais aucune réponse. Deux dossiers déposés au même moment ne seront presque jamais traités au même moment.
Et les critères pour recevoir concrètement l’appui du MCAT/ DGCA ? Mystère et boule de gomme !
Pour la grande majorité des cinéastes, les réponses données à leurs dossiers de demande de financement auprès du ministère se suivent et se ressemblent « Nous avons bien reçu votre dossier de…mais compte tenu de nos contraintes budgétaires nous avons le regret de…mais nous vous souhaitons bon courage, etc. ». Vous pouvez recevoir ce type de courrier et juste après le vôtre, un autre dossier arrive sur la table du Ministère de la culture/DGCA, et miracle, il y’a un financement disponible pour ce dernier.
Toujours est-il que, pour les plus « chanceux », (ils ne sont pas nombreux), du jour au lendemain vous apprenez qu’ils sont en tournage et qu’ils ont reçu un appui financier du MCAT/DGCA, dont le montant varie de 3 à 15 millions. (Il n’existe pas un site où l’on peut voir le montant de ces appuis comme dans les autres pays, donc nous nous fions aux informations qui filtrent jusqu’à nous). Ces projets en question sont presque toujours des « longs-métrages ».
Ces films appelés longs-métrages sont à peine des téléfilms de bas étage si on veut les classer coûte que coûte dans une section. Le téléfilm est un autre genre et qui n’a aucun complexe face au long métrage. C’est d’ailleurs une très bonne chose qu’il y’ait toutes les catégories dans la production d’un pays. Par contre ni le réalisateur d’un presque-téléfilm, ni son bailleur de fonds éventuel, ne doivent prendre ce « téléfilm » de 90 minutes par exemple pour un long métrage cinéma de 90 minutes et vouloir en faire un modèle pour une cinématographie majeure comme celle du Burkina. L’idée développée dans ces films tient difficilement dans un court métrage professionnel de 13 minutes.
Tout le monde gagnerait à ce que ces « chanceux » passent par la réalisation d’un minimum de 2 courts métrages sélectionnés dans des festivals de cinéma reconnus avant de venir taper à la porte du ministère de la culture pour un film de long métrage. C’est ce qui est exigé par les fonds qui font référence. En Tunisie il faut faire 5 courts-métrages aux critères que je viens de citer avant de demander l’appui de l’État. Ces courts-métrages sont bien entendu financés ou cofinancés par l’État. Pour info, un festival comme le Fespaco n’a pas encore une section dédiée à cette catégorie de téléfilms pour la compétition. Les autres festivals de référence comme Carthage, Montréal, Venise, etc. Non plus.
Même si le but de ce type de production est de remplir les 3 dernières salles de cinéma du Burkina, ou de promouvoir la réalisation de premières œuvres, la création d’une aide sélective digne de ce nom est un chemin moins tortueux pour y arriver, et en produisant au passage des œuvres de qualité à l’abri de toute suspicion ou polémique inutile.
Le Fonds de Développement de l’Industrie Culturelle et Touristique (FDCT)
Depuis quand les choses fonctionnent ainsi ? En tous cas cela ne date pas de l’actuel ministre Abdoul Karim Sango, ni de son prédécesseur Tahirou Barry. Mais les choses sont allées en s’amplifiant. Et rien ne laisse entrevoir la fin de ce cycle de production très peu transparent et improductif pour notre cinéma.
C’est dans ce contexte que le FDCT (Fonds de Développement de l’Industrie Culturelle et Touristique) est arrivé en 2016, suscitant un très grand espoir au niveau du monde culturel en général et du monde du 7e art en particulier.
Ouf on tenait enfin nous aussi, notre fonds. Avant l’installation du FDCT les premiers échanges avec les futurs responsables portaient sur une cagnotte de 3 milliards environ pour la culture et le tourisme.
Lors de la seconde vague d’entretiens on nous a parlé de 800 millions dont l’utilisation ferait l’objet d’une évaluation avant la mise en place d’un fonds de 3 milliards environ. Toujours est-il que dans une interview accordée au journal en ligne « Lefaso.net » du 9 juin 2020, le DG du Fonds Alphonse Tougma a expliqué que le FDCT avait pu mobiliser la somme de Trois Milliards Neuf Cent Quarante Six Millions de francs cfa (3 946 000 000 FCFA ou 6 015 000 euros) entre 2017 et 2019.
Dans la même interview le DG du FDCT dresse un bilan des 3 années de son fonctionnement 2017, 2018, 2019, où il parle de plus de 170 projets financés.
Si dans l’absolu ce nombre de 170 est impressionnant, on reste bouche bée quand on se penche sur l’enveloppe financière correspondante, qui est d’un peu moins de Cent Soixante Seize Millions (176 000 000) de FCFA ou (268 000 euros) dépensés, ce qui donne un ratio de Un Million Trente Cinq Mille FCFA (1 035 000 FCFA ou 1578 euros ) par projet.
On est plus proche d’un organisme de microcrédit que d’une institution de promotion et de soutien à l’industrie cinématographique. Je souligne bien industrie cinématographique.
Mais s’il y’a des esprits « perspicaces » qui pensent que dans ces 176 millions dépensés sur 3 ans, il y’a peut-être un film qui a été subventionné à hauteur de 50 ou 100 millions, je les renvoie aux « Descriptions, modalités et conditions de bénéfices des prestations…du Fonds FDCT ». Il y est mentionné que le seuil du volet subvention est de 10 millions de FCFA (15 244 euros) , et celui de l’avance sur recettes, de cinq millions de francs FCFA ( 5000 000 FCFA ou 7622 euros) , avec des intérêts de 1 à 6% et des frais de dossiers de 0,5% qu’aucune autre institution de ce genre ne pratique dans le domaine du cinéma. Au passage je vous informe que nous avons l’avance sur recettes la plus petite du monde.
Et ce n’est pas seulement le monde du cinéma qui pleure, faites un tour au CITO (Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou), à Reemdogo (Musique), à l’Espace Gambidi, au Théâtre de la Fraternité, aux écoles de danse (CDC, EDIT, etc.) à Imagine (formation), tout ce beau monde vivote. Ils ne doivent leur survie (jusqu’à quand ?) que grâce aux financements suisses, français, allemands, luxembourgeois, belges, danois, suédois, etc. dans le pays de la culture.
N’allez pas croire que je suis contre le FDCT ou son DG, Alphonse Tougma, un homme très compétent, et bien au parfum des problèmes de notre secteur. Mais je crois qu’il est loin d’avoir les coudées franches et des objectifs clairs pour agir comme les responsables des fonds d’autres pays. Le problème ne vient donc pas de là.
Le FDCT tel qu’il a été pensé n’a rien changé et ne changera rien au paysage culturel ou cinématographique burkinabé. Son échec en ce qui concerne notre métier est programmé depuis sa conception avec 18 secteurs différents dont le cinéma/audiovisuel qu’il doit piloter. Il s’agit de :
1 La musique (disque et spectacle)
2 Le cinéma et l’audiovisuel
3 livre et presse
4 les arts de la scène
5 les arts visuels,
6 le patrimoine culturel,
7 les métiers d’art,
8 la mode et le design,
9 le tourisme culturel
10 les tics (logiciels et multimédias)
11 l’hébergement touristique
12 la restauration touristique
13 le transport touristique
14 le tour opérating et l’équipement des agences de voyage
15 la chasse et la vision
16 le guidage,
17 l’aménagement des sites
18 l’attraction et l’animation touristique
Mais ils n’ont pas mis la pêche, la chasse et le patinage artistique, c’est déjà ça ! lol
Plus sérieusement, j’ai cherché en vain une image qui illustrerait bien le FDCT, et ce que j’ai trouvé est un taxi moto burkinabè (3 roues) ayant embarqué les acteurs de ces 18 domaines hétéroclites. Avec un attelage aussi disparate, le conducteur a choisi de rester sur place, et c’est ce que le FDCT fait, du moins en ce qui concerne le cinéma et la culture dans son ensemble.
En effet dans le bilan fait par le DG du FDCT, a-t-il cité un seul film de long métrage ou de court métrage de fiction, un documentaire, une série TV, un dessin animé d’envergure sélectionné ou primé dans un festival international, une seule grande pièce de théâtre financée pour une tournée nationale ou internationale, une seule salle de cinéma en construction ou en rénovation ?
Après cette interview, un seul responsable du ministère de tutelle a-t-il sauté au plafond pour dire que ce bilan était l’aveu d’échec du FDCT vis-à-vis du rôle en principe capital de cette institution pour notre culture, cinéma compris ?
C’est donc clair que le Burkina n’a pas de fonds de soutien pour son cinéma, et n’a même pas l’intention d’en créer, parce que le refrain actuel attribué à certains hauts responsables du ministère nous éloigne chaque jour un peu plus de cette probabilité. Je vous le rapporte presque textuellement ce refrain : « On donne des subventions aux cinéastes, ils ne font pas de bons films, maintenant, on ne va leur donner que des prêts ».
Cette phrase qui sonne comme une sanction à l’égard des cinéastes, ne résiste pas un seul instant à l’analyse.
Avec des appuis de 3, 5, 10 ou 15 millions pour un projet de long métrage qui n’a que cette seule ligne dans son plan de financement, l’on s’attend à quels types de films ? Même pas le Nollywood des débuts ou sous sa forme actuelle (que je vais aborder plus bas). Si on veut analyser ce type de production, en quelques mots on pourrait dire que c’est un système où seul le réalisateur/producteur est gagnant peut-être financièrement, mais pas artistiquement. Le film est tourné, monté et fini en 2 ou 3 semaines.
L’exploitation du film en salle rapporte rarement en brut plus de 5 millions de FCFA que le réalisateur/producteur considère comme étant son bénéfice pendant que techniciens, comédiens et toute la chaine de production sont sous-payés ou pas payés. Le réalisateur/producteur change en général de numéro de téléphone après chaque tournage, ou alors il a au moins 5 numéros de téléphone pour fuir ceux qui ont participé au tournage dudit film, etc.
Ne pas singer le Nollywood des débuts
Quant au Nollywood burkinabè prôné par d’autres, je l’ai déjà analysé dans d’autres interventions TV ou lors d’ateliers sur les films à petits budgets, donc je le résume.
Le Nigéria, avec son Nollywood, a une population de près de 190 millions d’habitants. Quand un DVD est vendu à 500 000 exemplaires soit 0,26 % de la population, en raison de 300 FCFA l’unité, il fait une recette de 150 millions de FCFA. Le coût moyen actuel du film Nollywoodien étant de 100 000 euros environ (65 millions de FCFA), cet investissement s’amortit en quelques jours ou quelques semaines au Nigéria.
Si vous mettez 65 millions de FCFA dans un Nollywood burkinabé, et vous cherchez la rentabilité à la Nollywood, vous vous exposez à plusieurs problèmes, en tous cas dans la configuration actuelle de notre cinéma et de notre pays.
1er problème : Excluons d’office l’exploitation DVD, parce que la piraterie est devenue un métier presque légal au Burkina, malgré tous les efforts du Bureau des Droits d’Auteur (BBDA). Un seul exemplaire de DVD était copié et recopié gratuitement par tout un quartier, diffusé gratuitement dans des centaines de cars vidéo et les ciné-clubs, et j’en passe.
Les dizaines de milliers de DVD du film « Congé de Mariage » de Boubacar Diallo, par exemple, ont fait plus le bonheur des pirates que des Films du Dromadaire. J’ai suivi mon propre film « L’œil du Cyclone » plus de fois dans les cars vidéo entre Ouaga et Bobo que durant deux ans dans les festivals de cinéma. Aujourd’hui la clé USB aux mains des pirates, a pris le relais du DVD et continue ce boulot funeste contre les réalisateurs et les producteurs.
2e problème : Vous ne pourriez pas rentrer dans vos fonds avec nos 3 salles de cinéma. Aucun film n’a fait plus de 60 000 entrées depuis au moins 5 ans. Même à 60 000 entrées, en raison du ticket à 1000 FCFA, le film aurait des recettes de 60 millions de francs Fcfa, en sachant que la salle de cinéma garde les 50% de cette somme. Vous ne dépasserez donc pas les 25 millions de recettes brutes, desquels vous devriez tirer ensuite des bénéfices pendant que vous auriez dépensé 65 millions au départ.
3e problème : la qualité du film ne permet pas d’affronter les marchés extérieurs, sauf par la piraterie. Il y’a un budget minimum en dessous duquel on ne peut descendre si on veut atteindre les standards internationaux en matière de qualité et même de normes. Rien que le budget moyen de la postproduction d’un long métrage professionnel vaut 70 millions de nos francs, même sans effets spéciaux.
4e problème lié au 3e : difficile pour le film d’être sélectionné dans les grands festivals internationaux, Fespaco compris, à plus forte raison y récolter des prix. Inutile de dire que ces grands festivals et ces distinctions éventuelles contribuent à la notoriété des films, des réalisateurs et au rayonnement des pays d’origine de ces films. Ils permettent également aux réalisateurs et aux producteurs de conclure des ventes, et de mettre les nouveaux projets dans les circuits de production. Notre cinéma est malheureusement de plus en plus absent de tous ces festivals qui comptent dans le monde.
Quant à l’actuel Nollywood du Nigéria, il évolue vers le reste du cinéma mondial, à savoir un cinéma de standard international, avec des scénarios de qualité, des décors de rêve, des comédiens sans reproches sinon des stars, et des techniciens professionnels payés à leur juste valeur, donc des budgets conséquents. Bref, nous ne sommes plus dans le Nollywood des débuts. Ce n’est pas surprenant que le Nigéria soit un des premiers pays d’Afrique à pouvoir vendre à Netflix, la plateforme VOD américaine, son film « Lionheart » à plus du milliard de FCFA.
Un vrai fonds de soutien au cinéma veille à la qualité des films financés
Ce n’est pas le moment pour le Burkina d’abandonner ce que nous savons si bien faire, à savoir des films de qualité, pour singer Nollywood.
Mais revenons à la dernière partie du refrain, à savoir « on ne va leur donner que des prêts ». Quel commentaire faire de cette petite phrase ?
Juste dire que nous avons le choix entre financer notre cinéma comme les autres pays de cinéma ou vouloir à tout prix créer des institutions pour remplacer le système bancaire normal qui fait déjà bien son travail, à savoir donner des sous, se faire rembourser, en prenant au passage des intérêts. Que le prêt soit un plus, on peut le comprendre, mais qu’il soit la base d’une stratégie de production étatique, c’est inquiétant. Je ne suis pas sûr qu’un banquier traine un cinéaste devant les tribunaux parce qu’il aurait fait un mauvais film, s’il est sûr d’être remboursé de sa mise.
Au contraire un vrai fonds de soutien au cinéma peut à toutes les étapes de la production d’un film, résilier son contrat s’il se rend compte que le produit filmique qui est en train d’être fabriqué est tout, sauf un film, que les têtes d’affiches annoncées sont remplacées par de vulgaires inconnus, que le chef opérateur est le petit vidéaste du coin, que le scénario en tournage est une pâle copie de celui qui a été soumis, etc.
L’un des plus rigoureux de ces bailleurs est certainement l’Union Européenne, à travers entre autres, son fonds ACP/UE. Tous les cinéastes qui ont obtenu ce fonds savent que dès la signature du contrat, le réalisateur, son producteur et leur cabinet d’audit sont obligés de rédiger des rapports narratifs, des rapports financiers, des rapports d’audit, (même en plein tournage) jusqu’à la remise du produit final et même après.
Le budget accordé peut toujours être revu à la baisse et vous pouvez être sommé de rembourser à tout moment, tout ou partie de cette subvention. Plusieurs cinéastes burkinabè ont pu se plier à cet exercice jusqu’au bout, et d’autres, pas seulement burkinabè l’ont appris à leurs dépens. Le problème n’est donc pas un manque de sérieux des cinéastes burkinabè mais un manque de suivi de ceux qui octroient les fonds chez nous.
Et aucun cinéaste ne demande qu’un seul fonds lui verse tout le budget de production d’un film quel que soit le type de film, sauf décision du bailleur lui-même. Un apport de 100 à 150 millions à un projet sérieusement jugé est censé jouer un rôle de leviers d’autres fonds au Burkina, en Afrique et ailleurs dans le monde. Cette levée de fonds ne peut se faire malheureusement en 2 ou 3 mois, mais en 2 ou 3 ans, voire plus. Le projet avant tournage se retrouve ainsi avec 250 millions supplémentaires et les 80 % de ce budget total sont dépensés dans la plupart des cas dans l’économie du Burkina, la postproduction étant très souvent effectuée à l’étranger.
Fonds de Promotion et de Développement du cinéma
On va aller vers la dernière partie de cet article en évoquant le seul vrai appui au cinéma burkinabé mais qui n’est hélas, pas un fonds pérenne. C’est l’appui de la Présidence du Faso. On pourrait l’appeler « Appui Zorro », ou si vous préférez « l’Appui Jack Bauer » parce que c’est qui lui vient sauver la situation à la dernière minute. Il intervient quand le Burkina se rend compte à la veille du FESPACO que le pays organiseur n’a aucun film de qualité professionnelle pour le représenter.
Il brille par sa consistance, la qualité de sa commission d’attribution, et la rapidité du déblocage de ses tranches. À part l’OIF, très peu de fonds parmi ceux cités, peuvent l’égaler sur ce dernier aspect. Mais il demeure dans tous les cas un appui d’urgence, et comme tous les appuis de ce genre, il vient régler des problèmes ponctuels, pas des problèmes structurels. Cet appui de la Présidence du Faso consacre en fait l’échec des Fonds FDCT et Ministère de la Culture/DGCA. Et il appelle plusieurs questions :
1) Comment comprendre que d’un côté on puisse mobiliser une somme de plus de 3 milliards et de l’autre attendre que la Présidence du Faso intervienne avec un appui d’urgence ?
2) La taxe sur la téléphonie mobile est-elle toujours récoltée en faveur de la culture et du tourisme ? Si oui, la culture reçoit-t-elle sa quote part ?
3) La taxe télé qui est prélevée sur les factures d’électricité depuis près de 30 ans est-elle affectée en partie à la culture ?
Si tous ces mécanismes fonctionnent, comment se fait-il que ce pays pauvre qui a osé créer un bijou aussi convoité que le FESPACO n’ait jamais pu mettre sur pied un vrai Fonds de Promotion et de Développement de son cinéma, avec un règlement volontariste, une vraie commission de lecture de scénarios avec des sessions régulières, des membres reconnus émanant de tous les secteurs de la profession, un Centre National du Cinéma à la taille de son parcours et de sa renommée cinématographique depuis 1969 ? Aujourd’hui notre Centre National du Cinéma (DGCA), malgré tous les accords tacites ou réels signés avec les autres pays, Sénégal, Côte d’Ivoire, Maroc, France…est incapable de faire de la coproduction par exemple.
En effet les structures homologues d’Abidjan et Dakar répètent sans cesse aux cinéastes burkinabè « Nous on coproduit vos films, mais quand nos cinéastes viennent chez vous, votre CNC dit qu’il n’a pas d’argent ».
En rappel, nos grands-pères et arrière grands-pères avaient pris les routes du café, du cacao (Côte d’Ivoire et Ghana) et des arachides (Sénégal) à la recherche d’un avenir meilleur. Plus tard un groupe de voltaïques rêveurs et audacieux avaient décidé que le cinéma serait notre cacao, notre café et que le reste de l’Afrique nous verrait briller dans ce domaine et viendrait apprendre ça chez nous. Ils ont réussi et tenu leur pari pendant près de 40 ans.
Des politiques éclairés et très avant-gardistes avaient même pris leur courage et nationalisé les salles de Cinéma (le Président Lamizana, et son ministre des finances, Tiémoko Marc Garango) au moment où peu de gens connaissaient la valeur réelle de cet art.
Aujourd’hui, ironie du sort, les petits-fils de ces « braves rêveurs » reprennent ces mêmes routes du café, du cacao et des arachides malgré eux, pour aller travailler sur les plateaux de film d’Abidjan et de Dakar. Ils sont en effet plus d’une quarantaine de professionnels à ne devoir leur survie que grâce au cinéma ivoirien et sénégalais. Certains s’y sont installés et pas des moindres, face au chômage permanent dans l’ancien pays du cinéma qu’est devenu le Burkina.
Ainsi après la déstructuration des infrastructures du cinéma, c’est au tour des ressources humaines de nous échapper lentement mais sûrement.
Une cartouche d’or
Heureusement, la seule et dernière cartouche qui nous reste et elle est vraiment en or (pour le moment) c’est le cinéphile.
Dans ces 2 capitales citées, Abidjan et Dakar, quelle que soit la qualité d’un film et la puissance de sa promo, vous n’auriez jamais 2000 cinéphiles par jour pendant que Ouaga pourrait faire 3000 entrées journalières si toutes les conditions sont réunies et ce ne serait pas un record pour cette ville.
Nous pouvons encore, avec une vraie politique axée sur les salles de cinéma, multiplier ce chiffre de 3000 par 3 ou 4. Les cinéphiles sont encore là, mais ils sont devenus plus exigeants. En plus du confort de la salle et du confort de visionnement, ils veulent leurs cinémas à côté d’eux, comme leurs supermarchés. Dans nos villes devenues tentaculaires, très peu de cinéphiles sont prêts à se taper 30 minutes de route pour aller voir un film.
Pour comprendre ce que nous perdons chaque jour avec un cinéma pour 6 300 000 habitants, suivons cette simulation économique
Nous avons une capitale de près de 2 000 000 d’habitants que nous pouvons diviser en 10 gros quartiers qui disposeraient chacun d’un cinéma salle unique, ou d’un multiplexe. On n’aurait pas à construire forcément 10 nouvelles salles, puisque certaines salles actuelles étatiques ou privées ont besoin surtout de rénovation en profondeur. Ces 10 salles de Ouaga peuvent faire chacune 500 entrées pour les 3 séances, 18h30, 20h30, 22h30 soit 5000 entrées quotidiennes pour Ouaga.
Bobo-Dioulasso, de son côté avec ces 1 000 000 d’habitants pourrait rentabiliser 3 salles de cinéma en raison de 1000 personnes par jour pour les 3 salles et les 3 séances.
Nous avons une dizaine de villes provinciales peuplées de 80 000 à 170 000 habitants. Ces villes comptent des universités et/ou des grandes écoles, (école de santé, enseignement, finances etc…), sans compter leurs lycées et collèges. Les pensionnaires (hommes et femmes) de ces structures constituent le cœur de cible des cinéphiles actuels. À ceux-là il faut ajouter les fonctionnaires, les commerçants et petits commerçants, les nombreux travailleurs du secteur informel, du secteur minier, les jeunes paysans, etc. Les séances spéciales enfants sont également un bonus de spectateurs dans chaque ville.
De ce fait, dans notre simulation on pourrait prévoir à Ouahigouya (2 salles de cinéma), Koudougou (2), Fada (1), Dédougou (1), Tenkodogo (1), Diébougou (1), Banfora(1), Dori (1) Houndé (1), Gaoua (1). Ces villes peuvent compter ensemble 2000 entrées journalières soit 200 personnes par jour par ville, pour les 3 séances réunies. Des villes comme Ouahigouya et Koudougou ne se limiteraient pas à 200 entrées par jour, ce sont des villes connues pour leurs cinéphilies légendaires.
En comptabilisant les 5000 entrées journalières de Ouaga, les 1000 de Bobo-Dioulasso, et les 2000 des 10 villes provinciales, on arrive à 8000 entrées/jour soit 240 000 mensuelles et 2 880 000 entrées annuelles. Ce qui nous rapporterait en brut la somme de 2 Milliards Cent Soixante Millions (2 160 000 000) de Fcfa en raison du ticket à 750 FCFA (moyenne entre le ticket de 1000 FCFA et celui de 500 FCFA, on pourrait avoir aussi des tickets de 1500).
Vous croyez que je rêve ? Peut-être bien, mais en 1995 selon les données du cinéma burkinabè (et du CNC français) la fréquentation des salles de cinéma au Burkina a dépassé les 4 500 000 entrées avec une quarantaine de salles et seulement 10 millions d’habitants. Là j’ai fait une simulation volontairement minimaliste en tenant compte du climat sécuritaire actuel.
Poursuivons donc.
La taxe sur le ticket d’entrée, de 11 à 15 % inventée par le CNC et expérimentée par plusieurs pays dont le Burkina, serait prélevée sur ces 2 880 000 billets pour alimenter un compte qui servirait à soutenir tous les segments de notre secteur cinématographique dont l’aide au scénario, à la production, à la distribution, à l’exploitation, à la promotion, etc…Comme dans les pays où cette taxe est appliquée.
Dans notre simulation, après le prélèvement de cette taxe, il resterait encore assez de ressources pour les frais de fonctionnement des salles, les droits de location et d’achat des films burkinabè et étrangers, les traites liées à la construction de ces salles, etc…
Comme vous le voyez, nous avons de l’or à ciel ouvert que nous refusons de ramasser. Quand cet or ira bien en profondeur, c’est-à-dire quand les cinéphiles potentiels se détourneront du cinéma à force d’attendre, et se disperseront comme des animaux en divagation, attirés par de nouveaux loisirs, on pourra toujours dire que la salle de cinéma ne rapporte pas, et que le cinéma est budgétivore.
Et ceux qui croient que la salle de cinéma c’est du passé, à cause de la VOD (Vidéo à la Demande), qu’ils sachent que NETFLIX, un des géants de la VOD et pionnier de ce mode d’exploitation a acquis récemment des salles de cinéma mythiques de Hollywood comme l’Egyptian Theater, et le Paris Theater, et a prévu d’investir des centaines de millions d’euros dans ce secteur en Europe en commençant par Paris. En tout état de cause, sur la plupart des marchés, la salle de cinéma demeure encore la principale source de remontée de recettes pour les producteurs et distributeurs de films.
Terminons par la Covid 19, actualité oblige, pour dire que le ministère de la culture, des arts et du tourisme a débloqué récemment plusieurs millions de FCFA pour panser les plaies laissées par cette pandémie dans le secteur de la culture. Cela mérite plus que des félicitations.
Maintenant, à 6 mois du FESPACO 2021 , (même s’il doit être une édition en ligne comme partout ailleurs), le Burkina doit-il se présenter les bras ballants ou à nouveau avec des long- métrages, des documentaires et des séries TV, etc. faits dans la précipitation pour juste participer ?
Ensuite après les soins post-Covid, qu’est-ce qui est prévu à l’échelle structurelle pour sauver tous les secteurs de notre cinéma, et le reste de la culture avec ?
Sinon pour le moment, question cinéma, Ouagadougou est loin derrière le Sénégal, la Côte d’Ivoire et surtout le Maroc avec son Centre Cinématographique qui met 602 millions de francs Fcfa par long métrage de fiction soit 2/3 du budget global du film, budget évalué et validé par le CCM, 12 millions dans le court métrage de fiction, 60 millions dans le long métrage documentaire etc…
Pour la seule année 2018, le royaume chérifien a ainsi mis, tenez-vous bien, la somme de Neuf Cent Quarante Cinq millions (945 000 000) d’euros soit 620 milliards de Fcfa rien que dans le long métrage marocain. Dans la même année, 111 courts métrages, 18 téléfilms, 35 séries TV, 7 sitcom (NDLR, sitcom, c’est le genre Vis-à-vis ou commissariat de Tampy) ont été produits, et ces films ne sont pas comptabilisés dans les 620 milliards.
Quant à l’exploitation, le pays compte 30 salles de cinéma dotées de 65 écrans aux standards internationaux.
Face à cet étalage de capacités cinématographiques, on peut tout juste dire que « le Burkina est le seul pays où il existe une place des cinéastes africains » mais pas la Capitale du Cinéma Africain.
Si nous voulons être appelé Capitale du Cinéma africain, il y’a un prix à payer, mais nous ne sommes pas obligés d’être la capitale du cinéma africain, ni même une capitale culturelle.
Sékou Traoré
00226 72 19 20 92
Ouagadougou Burkina Faso
sekoutra@yahoo.fr
Réalisateur/Producteur et Directeur de Production.
Régisseur général et producteur exécutif sur Timbuctu de Abderhamane Sissalo
Directeur de Production Afrique sur « Un homme qui crie », « Gris gris » de Mahamat Saleh Haroun, « Bienvenue au Gondwana » de Mamane Moustapha dit Mamane, Cessez-le-feu et de plusieurs long métrages burkinabè ou étrangers.
Réalisateur de « l’œil du Cyclone », « Gorel », « Ismael, un exemple de courage », etc.